Parmi les nombreuses étiquettes estampillées sur les produits/services destinés à la vente, ou associées à certaines enseignes, seuls les labels garantissent un certain nombre de normes qualitatives définies dans un cahier des charges. Mais comment s’y retrouver ? Qu’est-ce qui différencie un label, d’une accréditation ou d’une marque ? Tous les labels se valent-ils ? Comment sont-ils construits ?
Bienvenue dans la « label sphère » !
1. Le B.A BA
Pas de définition juridique mais un document cadre : le référentiel
Qu’est-ce que qu’un label ?
Si le mot « label » ne dispose d’aucune définition juridique, le terme est néanmoins défini comme une marque distinctive créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit / service destiné à la vente, pour en certifier l’origine, en garantir la qualité ou la conformité avec les normes de fabrication.
La création de labels touche tous les secteurs d’activité (agricole, industriel, alimentaire, textile, environnemental, cosmétique, touristique…). Elle est subordonnée à l’élaboration d’un référentiel de critères élaboré par un collectif, afin de distinguer le produit (ou service) labellisé d’un autre apparaissant similaire sur le marché.
En sus des critères, la création d’un label amène aussi à définir des modalités de contrôle.
Le label est généralement attribué par un organisme public national, international ou accrédité (certificateur extérieur indépendant).
Il peut être privé (ex : Clef Verte par l’association Terragir) ou public.
Un label public est utilisé par la puissance publique pour inciter les acteurs économiques à suivre ses orientations. Dans cette idée, des fonds dédiés sont souvent accordés pour son obtention.
La labellisation est une démarche volontaire. S’y engager demande de respecter un référentiel et garantit en échange une certaine qualité d’offre rassurante pour le consommateur ou le visiteur. Dans la société actuelle et de ses enjeux liés à la raréfaction des ressources, la labellisation valorise la qualité d’un produit/service et témoigne d’une prise de conscience et de l’engagement vertueux du prestataire (ex : Agriculture biologique, Pavillon Bleu…).

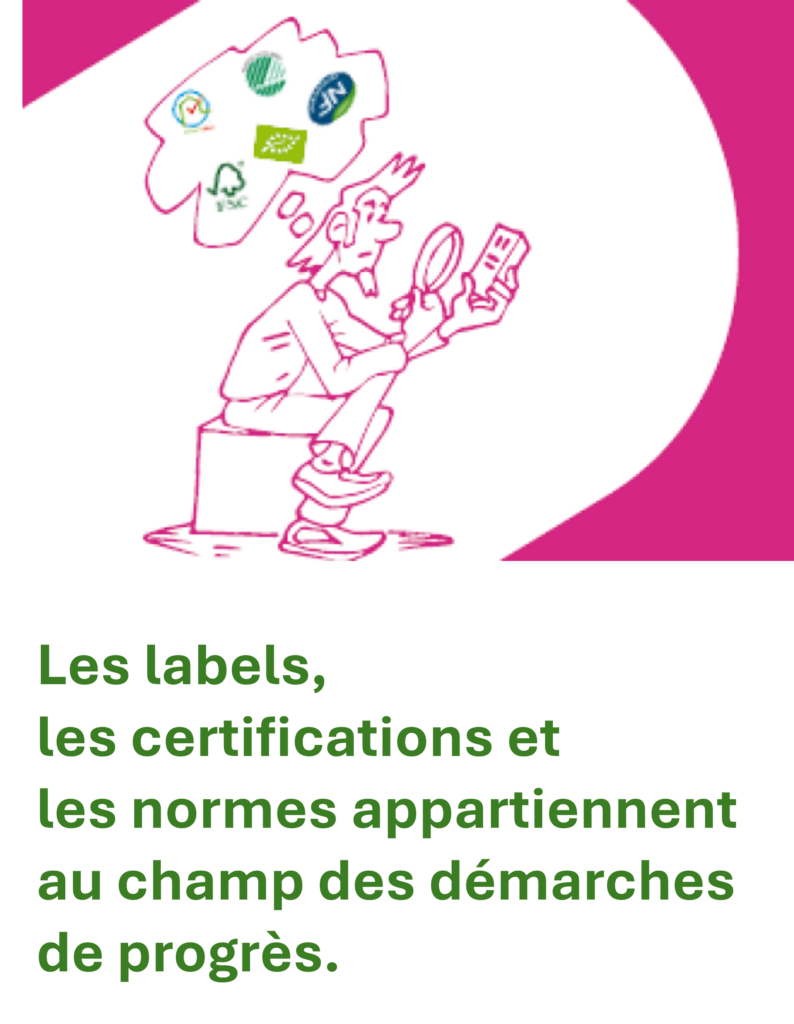
2. Label, marque, réglementation, certification et norme…
Quelles différences ?
1. La règlementation : elle est fixée par la loi et son application est imposée (ex : réglementation du stationnement).
2. La norme : elle peut être de 2 types
– réglementaire : elle est issue de la loi et son application est obligatoire (ex NF EN 60335-1/sur la sécurité des appareils électrodomestiques).
– ou volontaire : dans ce cas cas, elle n’est pas un règlement et forme un cadre de référence (lignes directrices, prescriptions techniques ou qualitatives pour les produits, services ou pratiques) au service de l’intérêt général. Elle est coproduite par les professionnels et les utilisateurs engagés dans son élaboration, qui s’accordent sur un ensemble de critères (ex : norme du format A4). Les normes volontaires sont à 90 % d’origine européenne ou internationale, reconnaissables à leur préfixe : ISO ou CEN par exemple. Une norme NF ISO est applicable uniquement en France. Elle est rédigée par un organisme de normalisation (ex : l’AFNOR).
3. La certification est une procédure volontaire permettant d’authentifier une démarche et d’obtenir un titre ou NF-X-730 « Activités des Offices de Tourisme ». Elle donne l’assurance écrite qu’un produit, un process ou un service est conforme à un référentiel de critères. Elle est délivrée par des organismes certificateurs et des pouvoirs publics*.
4. Le label est une marque distinctive apposée sur un produit pour en certifier l’origine, la qualité ou encore la conformité. Facultatif, il sert à montrer que l’entreprise atteint des objectifs spécifiques, plus contraignants que les normes. Des logos ou des signes particuliers sont associés aux labels afin de distinguer les produits/services labellisés.
Ces distinctions visuelles font l’objet de dépôt à titre de marques pour encadrer l’utilisation des labels et se défendre contre la fraude.
Ces marques relèvent de 2 catégories juridiques différentes :
– les marques « collectives » pour signaler son appartenance à une démarche collective. Ex : la marque MH (Monument Historique).
– les marques « de garantie » venant attester certaines caractéristiques vérifiées des produits/services auxquels elles s’appliquent. Ex : AB (Agriculture Biologique) ou HVE (Haute Valeur Environnementale).
Un label est dit écolabel quand il est en conformité avec l’ISO 14024. L’ ADEME définit 4 conditions nécessaires à son utilisation:
– disposer d’un référentiel accessible gratuitement sur les sites internet des écolabels
– avoir une certification réalisées par un organisme indépendant
– présenter des critères environnementaux portant sur l’ensemble du cycle de vie du produit/service
– présenter des critères environnementaux sur les différents impacts environnementaux que peut générer le produit/service
Ex : Ecolabel européen, Ange bleu *
*Source texte en italique : Guide 2025 des démarches de labellisation tourisme durable – ADN Tourisme & ATD
3. Quid des labels pour un tourisme plus responsable ?
Les labels en faveur d’un tourisme plus responsable s’appuient naturellement sur les marques et autres labels liés aux 3 piliers du développement durable (environnemental, social et économiquement soutenable).
Du côté des labels publics, les marques nationales du tourisme « Qualité Tourisme » et « Tourisme & Handicap » sont devenus labels d’État en 2024 et le label d’État « Destination d’excellence » a remplacé « Qualité Tourisme ». Ceci afin de répondre aux nouvelles exigences des clientèles et aux enjeux de la filière.
Les labels environnementaux
Enfin, l’Agence de la transition écologique (l’ADEME) a recensé de son côté, près de 100 labels publics et privés, classés par catégorie de produits pour permettre aux consommateurs de se repérer parmi les logos environnementaux.
Découvrez les garanties et les objectifs des labels recommandés par l’Ademe.


4. En Vaucluse
Les labels adaptés au tourisme responsable sur le territoire
Le tourisme responsable en Vaucluse tient compte de ses impacts environnementaux, économiques et sociaux dans son développement actuel et futur, en veillant à répondre aux besoins de ses visiteurs, ses professionnels et ses habitants.
Avec la démarche de transition, il s’est engagé dans un tourisme plus responsable en s’appuyant sur 15 labels, reconnus comme étant les plus pertinents pour le département au regard de ses caractéristiques (pleine nature, agricole, …).
Ces 15 labels soutenus en Vaucluse pour leur adéquation, concernent tous les acteurs du tourisme et sont adaptés à la structuration et la promotion du territoire. Ils répondent à un développement touristique durable réel ou incontournable et servent de base à la construction des offres en slow et écotourisme.
Ces 15 labels sont :
– Affichage environnemental (AE)
– Clef Verte
– Démarche RSE
– écotable®
– Ecogîte®
– Écolabel européen
– Gîte Panda
– Green Globe
– Hôtels au Naturel
– Valeurs Parc naturel régional
– Destination d’excellence
– Compagnon de route®
– Accueil vélo
– Jardin remarquable
– Tourisme et Handicap
